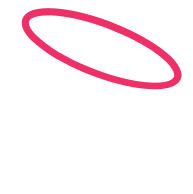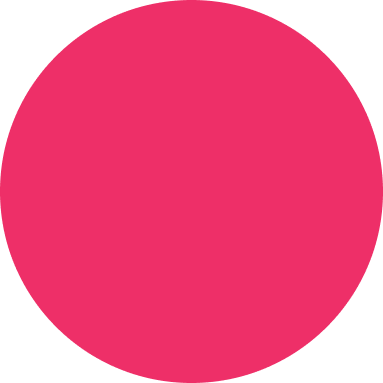RGPD Mode d'emploi pour Startups Santé
ou comment maîtriser les fondamentaux jusqu'à la mise en place d'une stratégie gagnante
Si le RGPD est largement connu, sa portée juridique demeure souvent
perçue de manière superficielle.
Voici les éléments clés à retenir pour les startups santé
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) constitue un cadre
juridique incontournable pour toutes les organisations manipulant des données
personnelles. Dans le secteur de la santé, la portée de ce règlement est
particulièrement critique, car les données traitées relèvent de catégories sensibles, à
la fois protégées par la loi et essentielles pour la recherche et l’innovation.
Cet article rappelle les principes fondamentaux du RGPD, les obligations en cas de
violation de données, ainsi que les méthodes permettant d’intégrer la conformité
dans une stratégie de gouvernance pérenne.
1. Les fondements du RGPD : principes directeurs et implications pratiques
Le RGPD repose sur sept principes directeurs, dont l’application est indispensable
pour garantir la conformité :
- Licéité, loyauté et transparence : tout traitement doit reposer sur une base
juridique clairement définie (contrat, obligation légale, consentement, intérêt
public ou intérêt légitime). Dans les études cliniques, l’articulation entre le
consentement du patient à participer à la recherche et le consentement au
traitement de ses données doit être rigoureusement distinguée. - Information : le responsable de traitement doit fournir aux personnes
concernées une information exhaustive incluant les catégories de données
collectées, les finalités poursuivies, la durée de conservation, les destinataires
et sous-traitants, l’existence de transferts hors Union européenne, les
coordonnées du DPO, et la référence aux autorités de protection des
données. - Limitation des finalités : la collecte de données doit être justifiée par une
finalité précise et déterminée à l’avance. Dans le cadre des essais cliniques,
par exemple, il s’agit d’évaluer l’efficacité et la tolérance d’un produit sur une
population donnée. Toute réutilisation doit être compatible avec la finalité
initiale ou faire l’objet d’une nouvelle information. - Minimisation des données : les données collectées doivent être strictement nécessaires à la finalité. Dans certains cas, l’année de naissance ou l’âge suffit, sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer la date complète.
- Exactitude : les données doivent être à jour et vérifiées. L’exemple du groupe sanguin erroné souligne les conséquences potentielles : biais scientifique, erreur thérapeutique, ou non-conformité aux bonnes pratiques cliniques.
- Limitation de conservation : la durée de conservation doit être définie avant le début du traitement. Les ordres de grandeur rappelés sont les suivants : Médicaments : environ 25 ans ; Dispositifs médicaux : 10 à 15 ans ; Thérapies innovantes : jusqu’à 30 ans. L’effacement, l’anonymisation ou l’archivage doivent intervenir à l’issue de cette période, sauf justification spécifique.
- Intégrité, confidentialité et responsabilité : les mesures de sécurité doivent assurer la disponibilité, la confidentialité et l’intégrité des données. Enfin, le principe d’ « accountability » impose une capacité de démonstration permanente de la conformité, toute action doit être documentée.
2. La gestion des imprévus : violations de données et droits des personnes
2.1 Les violations de données
Une violation correspond à tout incident entraînant la perte, la destruction, la divulgation, la corruption ou l’accès non autorisé à des données personnelles. Trois types d’atteintes sont distingués : confidentialité, intégrité et disponibilité.
Les chiffres présentés montrent l’ampleur du phénomène :
- 43 % des entreprises victimes subissent un arrêt de service de plus d’une journée
- les coûts moyens d’interruption se situent entre 300 000 et 500 000 euros
- la Commission National de l’Informatique et des Libertés (Autorité de Protection des Données française) a enregistré 5 629 notifications en 2024, soit une hausse de 20 % par rapport à l’année précédente
En cas de violation, la procédure standard comporte plusieurs étapes :
- Information immédiate au Délégué à la Protection des Données (DPD ou DPO en anglais)
- Évaluation du risque
- Documentation dans un registre des incidents
- Notification à l’autorité de protection des données dans un délai de 72 heures si le risque est avéré
- Information des personnes concernées en cas de risque élevé
- Mise en place d’actions correctives et suivi
Exemple : une entreprise d’hébergement subit une cyberattaque et voit ses données chiffrées contre rançon. Dans un tel cas, la violation concerne la confidentialité et la disponibilité, et l’existence de données sensibles implique un risque élevé. La notification à l’autorité de protection des données et l’information des personnes concernées deviennent obligatoires.
2.2 Les droits des personnes concernées
Le RGPD définit plusieurs droits individuels : accès, rectification, effacement, limitation, opposition, portabilité, retrait du consentement, droit de ne pas être soumis à une décision automatisée et droit de plainte auprès d’une autorité.
L’entreprise dispose d’un mois pour répondre, après vérification de l’identité du demandeur et analyse de la demande. Le refus est possible mais doit être motivé et documenté, notamment lorsqu’un droit est en conflit avec d’autres obligations légales ou scientifiques. L’exemple cité est celui d’une demande d’effacement dans le cadre d’une étude clinique : l’exécution invaliderait les résultats scientifiques, et doit donc être refusée avec explication.
Un défaut de réponse, un retard ou une information incomplète expose l’entreprise à des sanctions de la CNIL.
3. La construction d’un plan d’action RGPD
Il est nécessaire d’aborder le RGPD comme un processus continu, et non comme un projet ponctuel, en prenant en compte plusieurs axes d’action prioritaires :
- Mise en place d’un registre des traitements, document central qui est systématiquement demandé lors d’un audit
- Intégration de clauses RGPD dans les contrats avec les sous-traitants
- Réalisation d’analyses d’impact (AIPD) pour les traitements sensibles
- Anticipation des transferts hors UE par des mécanismes de garantie appropriés
- Déploiement d’une logique de privacy by design, intégrant la protection des données dès la conception des nouveaux projets
- Définition du rôle du DPO, qui peut être interne ou externe.
Voici une méthodologie progressive en cinq phases que vous pouvez utiliser :
- Identification des traitements et cartographie initiale
- Analyse des écarts avec les exigences légales
- Définition des priorités et planification des actions
- Mise en place des procédures, politiques, DPIA et mesures de sécurité
- Amélioration continue, audits et intégration systématique du RGPD dans la gouvernance
Des mesures simples et peu coûteuses peuvent renforcer la conformité : verrouillage automatique des postes de travail, interdiction des supports non autorisés (clés USB), usage exclusif d’outils approuvés, authentification forte, vigilance face aux tentatives de phishing.
Conclusion
Pour les entreprises de santé, la conformité permet non seulement de réduire les risques financiers et juridiques, mais aussi de renforcer la confiance des patients, partenaires et investisseurs, et d’augmenter la valeur intrinsèque de l’organisation.
Comme l’a résumé Gregory Collet, l’objectif est que les entreprises ne perçoivent plus l’audit comme une menace mais comme une opportunité d’amélioration et de valorisation.
Conseil d'Angels Santé
Face à la complexité et aux enjeux du RGPD, faites-vous accompagner par des experts du domaine comme MyData-Trust https://www.mydata-trust.com/
Contact France :
Luan Nguyen : l.t.nguyen@mydata-trust.com
Mathilde Jouet Delaroche : m.s.delaroche@mydata-trust.com
Propos recueillis par Angels Santé auprès de Gregory Collet, Délégué à la Protection des Données certifié chez MyData-Trust,
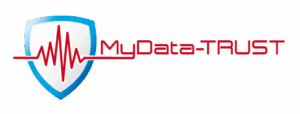
MyData-Trust – membre corporate d’Angels Santé